Ce qui frappe d’abord chez ces deux-là, paradoxalement, c’est leur amour de la Bretagne. Né en 1923 dans le quartier des Batignolles, Georges Poulot empruntera en 1952 à la ville de Perros-Guirec le pseudonyme de Perros (qui signifie « le bout du chemin » ou « le sommet de la colline », en breton) avant de s’installer définitivement, en 1958, à Douarnenez. Henri Thomas, de onze ans son ainé, a vu le jour dans les Vosges. De retour à Paris après avoir passé dix ans à Londres comme traducteur puis deux ans à l’université de Brandeis (Massachussetts) en tant qu’enseignant, il partira vivre sur l’île d’Houat (Morbihan) en 1982 et achèvera sa vie à Quiberon. La péninsule armoricaine n’est pourtant jamais un lieu pittoresque dans cette Correspondance mais une façon d’être au monde. « Ah l’essentiel c’est que tu ne désespères pas. Tu es dans le monde bien autant que moi, et d’après ta lettre, plus que moi qui me réveille chaque matin à découvert comme un objet échoué – ensuite la marée me recouvre, mais ce n’est pas très sérieux. Dans la journée, ça m’arrive aussi d’être à sec. Là-dedans, je ne me plains que de moi – j’insulte le vieillard qui arrive en moi, le vieux con ! Note qu’en Bretagne (je dirais quasiment notre Bretagne, étant donné que tu n’es ni plus ni moins breton que moi), j’espère encore devenir suffisamment étourdi pour me sentir au monde », écrit ainsi Henri Thomas à son cadet. Bien sûr, ni l’un ni l’autre n’ignorent la vie parisienne et les historiettes germanopratines, mais c’est peu dire qu’ils n’en font pas grand cas : « Oui, le Pont-Royal est une méchante fosse aux ours, il s’y ‟crée” un état d’esprit particulier qui ne manque pas d’unité : la hargne à répétition », écrit non sans humour l’ainé à propos du bar en sous-sol de l’Hôtel Pont Royal, tout proche des éditions Gallimard.
Les deux Bretons d’adoption s’écrivent, irrégulièrement certes, mais de plus en plus souvent et avec beaucoup de fidélité, des lettres pleines de pudeur et de notations déconcertantes qui font toute la force de cette relation épistolaire. Et si les premiers échanges étaient plus formels, consistant essentiellement en des envois des livres que l’un et l’autre publient, ils débouchent rapidement sur des impressions de lecture qui ne manquent ni de pertinence ni de finesse : « Je me suis toujours étonné de la manière dont vous étouffez l’anecdote au profit d’un mouvement souterrain, d’une source, d’une euphorie tout à fait désarmée », observe Georges Perros dans une lettre de 1964 à propos du Parjure, avant d’ajouter : « Quand je vous lis, je regrette toujours de vous connaître si peu. Mais je me dis en même temps que c’est un peu pédant de ma part. Vous vous passez très bien de moi. »
Ils se rencontrent pourtant, à Paris ou en Bretagne, et se tutoient à partir du 30 Juillet 1975. C’est à ce moment-là qu’ils abordent des sujets plus graves. De Paris où il réside alors, Henri Thomas confie à son correspondant : « Ma fille est rentrée d’Angleterre hier. Tristesse de ma vie : je ne peux même pas l’héberger, tu as vu mon perchoir. Ça me fait d’autant plus de mal qu’elle ne pense pas à me le reprocher. Et tout ça par ma faute : les négligences d’une vie se retrouvent en avant, comme un fumier infranchissable. » Très vite, ensuite, c’est le cancer de Georges Perros, l’opération à l’hôpital Laennec à Paris, en 1976, et le traitement au cobalt à Marseille qui le laisse sans voix : « Une centaine de silencieux, ici. Des jeunes filles, femmes, nous rééduquent, à partir de ces éructations, bagatelles pour beaucoup. Difficiles pour quelques-uns. Dont je suis. Elles ne me trouvaient pas trop bête, les premiers jours. Mais elles déchantent. On verra bien ! J’ai comme complice dans le mutisme un grand escogriffe assez âgé, concierge du cimetière marin de Sète. Alors on se récite en timbre mort quelques vers du poème. » (Il s’agit du « cimetière marin », de Paul Valéry, dont Perros avait suivi avec grand intérêt les cours au Collège de France, pendant la guerre.) Ou encore, cette anecdote sans emphase et si troublante : « Le matin, parfois, avant la mise en branle des soins etc… je vais tapoter sur un piano aux touches très cariées. Je suis seul. Ça dure un quart d’heure, vingt minutes. Je me lève, me retourne, et là, derrière moi, assis comme doivent l’être des tigres au repos dans la jungle, une dizaine de silencieux, qui rêvent, me demandent de continuer. On se croirait outre-tombe. »
Les deux écrivains n’ont jamais été aussi proches que dans ces dernières lettres. Elles y gagnent en émotion sans doute, mais sans que jamais l’un ou l’autre se départisse de cette retenue qui évite tout pathos. On y trouve parfois une touche d’humour, même teinté de ce pessimisme fondamental de ceux qui, sans le dire, savent : « Tous ces sursitaires charcutés ! c’est drôle d’ailleurs, l’uniforme des chirurgiens. Cuisiniers du Diable ! », écrit dans son ultime lettre Georges Perros, à propos de ses compagnons d’infortune, à Laennec.
Et jamais la littérature n’est oubliée, la leur et celle des autres : « À propos d’admiration, il faudra que nous parlions de Sartre ; je ne comprends pas bien ce qu’il t’a apporté. Au moment de L’Être et le Néant, je me rappelle qu’il a été supplanté toujours pour moi par Kierkegaard, et j’ai été tout à fait réfractaire aux Mots. Nous ne voyons peut-être pas la maison du même côté ? », demande Henri Thomas le 1er janvier 1976. Et c’est la même flamme qui brûle encore quand Georges Perros, après avoir accepté de rédiger la quatrième de couverture d’un de ses romans, fait cet aveu, le 27 février 1977 : « J’ai reçu un exemplaire de La nuit de Londres ce matin. Il est seize heures (!) et j’en termine une relecture haletante, je fume de partout, comme… un chien mouillé. Ce que ce livre dégage d’existence n’est pas indicible, mais extraordinairement cadré, comme dans le remords, sans arrêt, comme dans notre corps, parfois, traversé par la mort, future propriétaire. »
Georges Perros et Henri Thomas s’expriment sans prétention, ne prennent jamais la pose, et c’est peut-être ce qui rend ce petit livre si précieux. Ils y disent leur quotidien d’hommes et d’écrivains comme il se déroule, sans tricher, sans chercher à sculpter leur statue pour l’éternité. L’ensemble est complété par une magnifique « Conversation avec Henri Thomas » de Jean Roudaut, qui fut leur ami et qui signe aussi la préface, ainsi que par deux portraits croisés des écrivains aussi subtils que sensibles, comme cette Correspondance finalement, malgré cette chienne de vie qui l’a inspirée.
Thierry Romagné
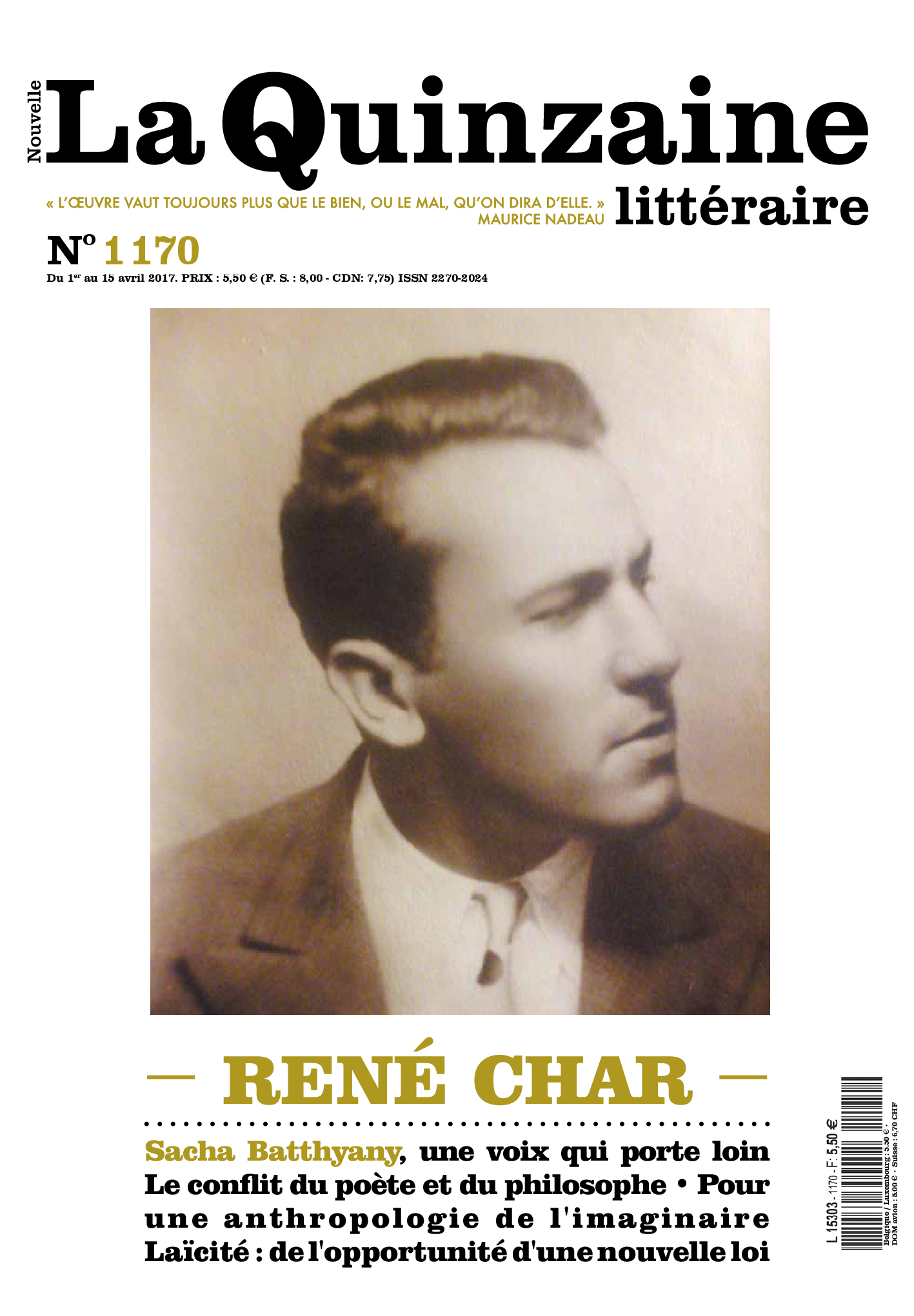

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)